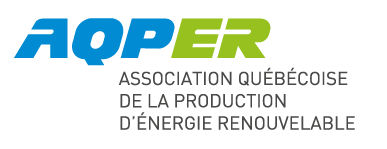Mémoire devant la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec
3 octobre 2013 - La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean souhaite que le gouvernement du Québec reconnaisse la volonté des communautés d’être considérées comme des partenaires incontournables en les associant au développement de toutes les formes d’énergies sur leur territoire.
C’est l’une des sept recommandations formulées dans le mémoire déposé par la Société et ses partenaires, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, la MRC du Domaine-du-Roy et la MRC Maria-Chapdelaine devant la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec qui s’arrêtait à Saguenay le 3 octobre dernier.
La Société a également profité de son passage devant les commissaires pour rappeler que l’arrêt surprise du programme d’achat d’électricité provenant de petites centrales communautaires de moins de 50 MW, décrété le 5 février 2013 par la ministre des Ressources naturelles du Québec Martine Ouellet pour des motifs essentiellement idéologiques, avait été une véritable gifle au visage pour elle et ses partenaires. En procédant de la sorte, le gouvernement envoyait ainsi l’un des pires messages qui soient aux communautés et allait à l’encontre des aspirations de longue date du monde municipal et des communautés autochtones pour soutenir leur développement. C’est pourquoi ils réclament une nouvelle fois la réhabilitation de la filière des petites centrales hydroélectriques et que celle-ci soit uniquement réservée aux communautés afin qu’Hydro-Québec puisse se concentrer au développement de projets de plus grande envergure.
«Nous sommes d’avis que les communautés doivent être systématiquement engagées dans la réalisation de projets énergétiques et que pour y parvenir l’État québécois doit aménager un cadre bien défini à l’intérieur duquel elles pourront manoeuvrer sans être inquiétées par les humeurs changeantes des gouvernements. La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean a fait la démonstration qu’il était possible de répondre aux besoins des Québécois en réalisant des projets en parfaite harmonie avec l’environnement dont les bénéfices permettent l’émergence de d’autres initiatives au profit des communautés et assurer leur développement à long terme», a témoigné M. Denis Taillon, président et porte-parole de la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean.
Le cadre auquel fait référence M. Taillon serait similaire à celui implanté en Ontario, basé sur le modèle Feed in tariff (FIT), ainsi qu’en Colombie-Britannique, où des communautés ont la capacité de développer à leur rythme des petits projets de production de différentes formes d’énergies et conclure ensuite une entente avec le distributeur d’électricité.
Lors de sa présentation, le président de la Société était accompagné de MM. Gilbert Dominique, chef de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine et Bernard Généreux, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy. Chacun a eu l’occasion de prendre la parole afin de sensibiliser les commissaires sur certains enjeux importants à prendre en considération.
M. Dominique a d’abord rappelé que la Société était issue d’un partenariat unique au Québec entre autochtones et allochtones qui partagent un intérêt commun pour le territoire et ses ressources. Le chef a vanté le choix qu’on fait les partenaires d’exercer un leadership en matière de développement de projet en mettant leurs ressources en synergie plutôt que de se livrer compétition entre eux pour les mêmes projets. Il a insisté sur la volonté de sa communauté d’obtenir sa part des bénéfices des projets touchant les ressources naturelles du territoire et la conclusion d’un partenariat stratégique avec ses voisins représente, à ses yeux, une voie porteuse en ce sens.
De son côté, M Boivin s’est servi de l’exemple du projet de minicentrale hydroélectrique de la 11e chute de la rivière Mistassini pour illustrer qu’un promoteur public est en mesure de développer des projets avec le souci d’intégrer les préoccupations des communautés et territoires d’accueil. Il a notamment cité en exemple la volonté de construire un pont qui permettra de désenclaver deux communautés éloignées. Sans être essentielle au projet,
l’infrastructure représentera une plus-value économique non-négligeable pour le milieu en étant au coeur du déploiement des stratégies touristiques relatives aux motoneiges et aux quads.
L’aménagement d’un parc écotouristique, sur l’île située à proximité des infrastructures, constituera également un élément attractif qui se greffera au Parc régional des grandes rivières, un concept de parc éclaté sur le territoire. Enfin, la présence de la minicentrale au fil de l’eau rendra le site moins favorable à la formation d’embâcles.
Pour sa part, M. Généreux a insisté sur le fait que l’exploitation des ressources énergétiques est intimement associée au territoire et que, par conséquent, l’époque où les véritables occupants et habitants de leur coin de pays ne retiraient que peu d’avantages de l’exploitation des leurs potentiels énergétiques était révolue. Le pays appartient à ceux qui l’occupent, alors il est tout à fait normal qu’ils se sentent interpellés au premier chef par leur mise en valeur. Trop souvent, les modèles de développement et d’exploitation des ressources ont fait fi de cette réalité qui prend tout son sens dans le désir de miser sur la réalisation de projets qui respectent les principes du développement durable, donc de l’intégration au milieu. Le gouvernement doit convenir qu’il est primordial d’accroître les opportunités d’engagement des populations dans les projets d’énergie. À ce titre, M. Généreux a formulé le souhait que la Commission s’inspire des recommandations du Groupe de travail sur le milieu rural comme producteur d’énergie mis sur pied dans le cadre de la Politique de la ruralité 2007-2014.
Dans leur mémoire, la Société et ses partenaires recommandent également que le gouvernement du Québec réduise de façon significative, à moyen et long terme, sa dépendance aux énergies non renouvelables en misant sur l’immense potentiel de production d’énergie verte sur son territoire. Ils s’entendent également sur l’importance, pour le gouvernement du Québec, de mettre à profit les surplus d’électricité actuels et proposer des stratégies économiques qui favorisent l’utilisation des énergies renouvelables dans une perspective de développement durable. «Maitriser et orienter notre avenir, n’est-ce pas là aussi un pas vers un meilleur développement durable? En examinant la Loi sur le développement durable du gouvernement du Québec, la réponse ne peut définitivement qu’être affirmative», de conclure Denis Taillon.
La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, organisme à but non lucratif créé en 2007, est issue d’un partenariat unique entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, la MRC Maria-Chapdelaine et la MRC du Domaine-du-Roy. Sa mission est de favoriser le développement de projets axés sur la mise en valeur des énergies renouvelables du territoire et de maximiser les retombées locales et collectives, dont celui de minicentrale hydroélectrique sur le site de la 11e chute de la rivière Mistassini.