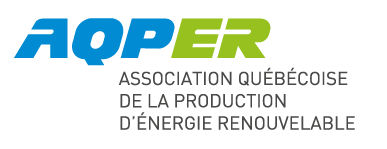Johanne Fournier
Collaboration spéciale
Le Soleil
11 mai 2014 - (Matane) Longtemps critiquée pour être une industrie aux crochets de l'État québécois, la filière éolienne effectue de plus en plus de percées vers des marchés d'exportation.
Plusieurs entreprises québécoises, qui ont développé une expertise au cours des dernières années en participant à la construction des parcs éoliens du Québec, profitent de la croissance des marchés extérieurs.
Selon l'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA), les projets de construction de parcs éoliens des États-Unis totalisent plus de 12 000 MW, en comparaison avec les 2400 MW actuellement en service au Québec et les 7800 MW au Canada. Toute forme de production d'électricité confondue, l'énergie éolienne a compté, dans les cinq dernières années, pour 30 % de la puissance installée aux États-Unis. Ce pays représente maintenant 19 % de la puissance éolienne en service dans le monde.
Mais le marché ne se limite pas exclusivement aux États-Unis. «On a des entreprises québécoises comme Boralex, Innergex, Kruger et Eolectric, qui ont développé des expertises en Europe, en Amérique latine et au Mexique, énumère le directeur de CanWEA pour le Québec, Jean-Frédérick Legendre. Elles font affaire avec des fournisseurs québécois qui sont eux aussi appelés à jouer un rôle à l'extérieur.» Celui-ci ajoute qu'il y a aussi un marché en Ontario, notamment en vue du remplacement éventuel des usines nucléaires et au charbon.
L'exemple de Marmen
Le président-directeur général de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER) estime, lui aussi, que l'avenir de l'exportation est prometteur pour l'industrie éolienne québécoise et que celle-ci se positionne à l'extérieur du Québec.
Il cite en exemple l'entreprise Marmen de Trois-Rivières. «Marmen a acheté des compagnies aux États-Unis, mentionne Jean-François Samray. C'est maintenant le deuxième plus grand fabricant d'éoliennes en Amérique du Nord. Marmen est un exemple qui s'est vraiment développé grâce à la filière éolienne au Québec.»
De l'avis de M. Samray, l'industrie éolienne québécoise peut aussi tirer son épingle du jeu dans des pays dont les parcs sont rendus à la phase de renouvellement de leurs équipements, tels le Danemark, la Grande-Bretagne et l'Allemagne.
Par ailleurs, le directeur général du TechnoCentre éolien croit qu'il est injuste de considérer la filière éolienne comme étant tributaire des deniers publics. «On a invité les gens à installer des usines chez nous en leur promettant 60 % de contenu québécois dans les projets, fait valoir Frédéric Côté. On a donc non seulement développé une capacité manufacturière, mais on a aussi développé des compétences et des savoir-faire qu'aujourd'hui, on commence à exporter.»
Selon un sondage maison réalisé par son organisme, les manufacturiers de l'Est-du-Québec ont exporté, en 2012, des composantes d'éoliennes pour environ 300 millions $. Le TechnoCentre ne dispose cependant d'aucun chiffre faisant état de la portion que cet apport économique représente dans le chiffre d'affaires total de ces entreprises. Par contre, l'organisme estime à 5000 le nombre d'emplois créés dans l'industrie, dont 1200 en Gaspésie et dans la Matanie.
Complémentarité
Les entreprises exportatrices se confrontent à certains obstacles, dont le protectionnisme pratiqué par les régions où elles veulent faire des affaires. Selon les porte-parole de la filière éolienne, l'avenir réside dans la complémentarité. «Les entreprises qui exportent sont celles qui sont capables d'apporter une valeur ajoutée avec les coûts de fabrication les plus bas», estime Frédéric Côté. Il fournit en exemple le cas de LM Wind Power de Gaspé qui était, jusqu'à tout récemment, l'usine pouvant fabriquer les plus longues pales au Canada et sur la côte est de l'Amérique du Nord.
Pour voir l'article dans son contexte original, cliquez ici.