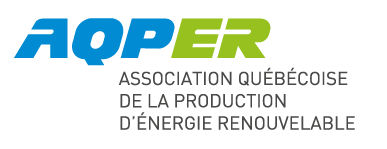Profil détaillé
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER)
L’AQPER est une association des producteurs d’énergie renouvelable. Il s’agit d’une organisation qui a été créée au début des années 90, alors que le Gouvernement a décidé de procéder au développement, de ce que nous appelons chez nous, de petits sites hydrauliques et, notamment la réfection de centrales délaissées par Hydro-Québec. Dix ans plus tard s’y sont ajoutées l’énergie éolienne et celle de la biomasse. À titre d’exemple, les entreprises que l’on retrouve dans ce groupe sont Axor, Boralex (Cascades), Énergie renouvelable Brookfield (Brascan), Hydroméga, Hydro-Sherbrooke, Innergex, qui sont des producteurs. Ces entreprises sont entourées et assistées dans leur rôle par plusieurs représentants du milieu des ingénieurs-conseils, de constructeurs, d’études légales, comptables, d’institutions financières, d’experts en environnement, en évaluation des ressources éoliennes, etc. Au total, environ 75 sociétés et/ou organisations.LE RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ DANS L’ÉNERGIE AU QUÉBEC
Grâce à son immense territoire doté de nombreuses et puissantes rivières, le Québec occupe en Amérique du Nord une place enviable sur le plan énergétique. Il n’y a aucune centrale au charbon et seulement une centrale nucléaire de même qu’une installation thermique desservant la pointe. Si bien que près de 95 % de son électricité, soit quelque 40 000 MW, provient de source hydraulique, propre, renouvelable et transportée à très haute puissance sur de très longues distances en provenance du Nord. Les surplus disponibles sont dirigés vers les Maritimes, l’Ontario et vers le nord-est américain, soit en permanence via une ligne dédiée, soit de manière ponctuelle sur le réseau en fonction des besoins et des opportunités.
La taille exceptionnelle d’Hydro-Québec ainsi que des rivières qu’elle gère et qu’elle développe a fini par occulter le fait que le Québec dispose aussi de plus de 4 000 cours d’eau de moindre importance où se trouvaient d’ailleurs de « petites » centrales qu’Hydro a délaissé pour mieux s’occuper des immenses bassins placés sous sa responsabilité, chaque fois qu’un projet dépasse la taille des 50 MW. Or, le Québec disposait justement d’une expertise en génie conseil et d’un ensemble d’entreprises industrielles compétentes pour prendre en charge les sites délaissés, les mettre à niveau et en développer de nouveaux, lesquels étaient jugés trop petits chez nous, mais qui feraient néanmoins l’envie de n’importe quel pays industrialisé. Même les pays les plus hautement touristiques, comme la France et l’Italie, ont utilisé à son maximum tout leur potentiel hydraulique dans le plus grand respect de l’environnement.
Les entreprises québécoises ont relevé ce défi dans les années 90 et se sont alors regroupées au sein d’une association au moment où elles devaient répondre à l’appel d’offres lancé par le Gouvernement. De belles réalisations ont été faites, dont plusieurs se sont méritées des félicitations et des prix pour la qualité de leur insertion dans le milieu. Une centrale de 40 MW vient d’être mise en service sur la majestueuse Magpie, sur la Basse Côte-Nord, au coût de 75 millions. Plus de 300 MW sont ainsi générés par les entreprises privées du Québec, au-delà évidemment de la forte production des autoconsommateurs comme l’Alcan.
Dans le cadre de la nouvelle stratégie énergétique initiée par le Gouvernement, une relance s’amorcera bientôt dans les petites centrales, à l’initiative des municipalités des régions-ressources qui souhaiteront en accueillir chez elles pour améliorer leur bien-être économique. Au même moment, l’activité des entreprises québécoises a continué de se déployer en Ontario et dans l’Ouest, jusqu’en Colombie Britannique.
Pendant cette même période, les entreprises de chez nous ont consacré beaucoup de ressources humaines, techniques et financières pour apprivoiser les nouvelles technologies de l’éolien et se placer ainsi en position de saisir les opportunités susceptibles de se présenter au Québec. Déjà des tentatives avaient été lancées dans le secteur par Hydro-Québec avec des prototypes et certaines entreprises ont été prêtes à assumer les risques d’innover dans la production d’électricité. Mais c’est véritablement avec les investissements massifs de grandes sociétés industrielles, surtout européennes du Danemark, de l’Allemagne et de l’Espagne, que sont nés les équipements modernes permettant de produire de l’électricité de manière fiable, à un coût acceptable.
Le Gouvernement du Québec s’est très tôt intéressé à cette nouvelle filière prometteuse et a vite trouvé dans le secteur privé des interlocuteurs compétents en analyse de potentiel de vent, de génie-conseil, de producteurs d’électricité, de fabricants d’équipement, en financement de projets énergétiques, etc. L’Association des petits producteurs hydrauliques s’était déjà transformée d’ailleurs en une Association des Producteurs d’énergie renouvelable (AQPER).
Ayant reçu un avis favorable de la Régie de l’Énergie du Québec, appuyée en cela par Hydro-Québec, le gouvernement du Québec a lancé un appel d’offres pour 1 000 MW d’éolien devant être réalisé en Gaspésie, où devaient d’ailleurs se retrouver au début 40 % et plus tard 60 % des retombées économiques du programme. Cet appel d’offres a suscité des projets pour 4 000 MW, dont évidemment les 1 000 MW les plus avantageux ont été choisis par Hydro-Québec en fonction d’une grille d’analyse et de pondération appliquée sous la surveillance d’une grande société d’experts-comptables. Le caractère très compétitif (6.5 c/kwh) a surpris tous les observateurs.
Le premier parc a été inauguré le 1er décembre dernier à Baie des Sables, près de Matane en Gaspésie, et les autres implantations suivent en cadence. Les investissements totalisent 1,5 milliard de dollars de la part du secteur privé, plus un montant de 0,5 milliard de la part d’Hydro pour le réseau de transmission. Trois usines ont été construites dans le territoire pour la fourniture des tours, des nacelles et des pales. Elles sont québécoises ou étrangères, dont une du Danemark qui emploie 300 personnes dans la petite ville de Gaspé pour la fabrication des pales ainsi que deux autres à Matane pour la réalisation des tours et des nacelles. Le système scolaire et les entreprises combinent leurs efforts pour la formation adéquate du personnel.
Fort de ce succès, le Gouvernement a lancé un second appel d’offres de 2 000 MW pouvant être implantés partout au Québec où le réseau peut raisonnablement les recevoir. La date du dépôt des soumissions était le 18 septembre 2007. Le volume de propositions a dépassé très largement la quantité recherchée, soit près de 8 000 MW. Les projets retenus ont été dévoilés ce printemps, en début mai. Les investissements requis dépasseront les 4 milliards.
L’afflux d’investissements aussi massifs en Gaspésie a évidemment suscité, en certains milieux, les réactions et les appétits les plus divers. Il faut dire que pour plusieurs, la technologie apparaît bien simple : « il n’y a qu’à attraper le vent qui nous appartient »!
Donc, ont clamé certains contestataires, « les entreprises viennent s’enrichir à nos dépens en profitant de notre vent ». Une meilleure information a permis de faire comprendre aux intéressés l’ampleur des sommes requises et surtout le niveau de risque associé à ce genre d’entreprise, que même Hydro-Québec ne voulait pas assumer, jugeant de beaucoup préférable de recourir au processus d’appel d’offres auprès du privé et que le consommateur en sortirait gagnant.
Beaucoup de Québécois, subjugués par l’immense succès de la nationalisation d’Hydro-Québec il y a un demi-siècle, ne comprenaient pas pourquoi le développement de l’éolien ne lui était pas confié. En pratique cependant les différences ne sont pas si grandes qu’il n’y paraît. Hydro-Québec fait appel à du capital étranger, à des sociétés de génie-conseil, à des fabricants d’équipements dont les usines appartiennent soit à des américains, soit à des français, tout comme le secteur éolien obtient ses composantes de fournisseurs québécois ou étrangers, mais largement installés sur place. Et les producteurs n’ont qu’un seul client, Hydro-Québec qui agit en maître d’œuvre.
Comme il s’agit d’un secteur et d’un processus nouveaux, certains groupes ont voulu y voir un développement « anarchique » alors qu’au contraire les mesures d’encadrement émises par le Gouvernement et Hydro sont très nombreuses et contraignantes, à telle enseigne d’ailleurs qu’il faut compter au moins 3 ou 4 ans entre le concept d’un projet et sa réalisation. Et les audiences publiques y tiennent un rôle crucial.
Les choses rentrent maintenant dans l’ordre et le Gouvernement a déclaré vouloir satisfaire d’autres attentes formulées par les municipalités et les communautés autochtones. Chaque groupe recevra un bloc de 250 MW.
Au sortir de ce vaste programme au milieu de la prochaine décennie, le Québec disposera alors d’une capacité d’au moins 4 000 MW qui représentera grosso modo 10 % de l’actuelle capacité hydraulique d’Hydro-Québec.
En y ajoutant les initiatives annoncées dans la Stratégie énergétique pour le solaire, la biomasse, la géothermie, etc., le Québec disposera d’un portefeuille exemplaire d’énergie propre et renouvelable, grâce à la formidable concertation qui aura été orchestrée avec le milieu, Hydro-Québec et nos entreprises dont l’expertise est reconnue dans tout le continent. Au Québec, l’énergie, c’est un motif de fierté pour nous tous !