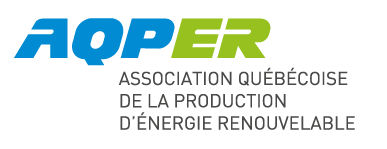Articles
Énergie éolienne
- Détails
Le premier parc éolien québécois a vu le jour en 1998 en Gaspésie. Depuis, la filière éolienne a dynamisé l’économie régionale de plusieurs régions du Québec, créé un créneau d’excellence pour la technologie québécoise et s’est imposée en tant que source d’énergie verte, fiable et économique.
Le Québec dispose d’un immense gisement éolien dont seule une infime partie (0,1 %) a été mise à contribution. La production éolienne se compare maintenant avantageusement à celle des grands projets hydroélectriques, et ce, autant en termes de fiabilité que de coût.
Plus précisément, le prix de vente pour les 450 mégawatts d’éolien qui seront produits à compter de 2016 est de 6,3 ¢/kWh. Les développements technologiques et le savoir-faire de nos entreprises placent donc le Québec dans une situation extrêmement avantageuse.
Lorsqu'elle est exportée aux États de la Nouvelle-Angleterre, l'électricité produite par la filière éolienne québécoise génère des attributs environnementaux (RECs) qui lui confèrent une prime pouvant se chiffrer jusqu'à 6,4 cents du kilowattheure. Vous trouverez ici le rapport rédigé par La Capra Associates sur la valorisation des attributs environnementaux. (Disponible en anglais seulement.)
L'énergie éolienne :
- Réduit les gaz à effet de serre en remplaçant les énergies fossiles;
- Ne génère ni déchets, ni pollution de l’air;
- Est la forme de production énergétique ayant le meilleur bilan environnemental
Monsieur Matthieu Féret, directeur de projets, PESCA Environnement, a mis à jour le contenu de la présentation faite lors de notre Colloque 2016 sur les dix ans suivis fauniques post-construction au Québec.
Même si elle est particulièrement bien ancrée dans les communautés de l’Est, c’est tout le Québec qui bénéficie des retombées économiques de la filière éolienne :
- 1 200 emplois directs en Gaspésie et dans la MRC de la Matanie ;
- 4 000 emplois ailleurs au Québec, dont 1000 dans la région de Montréal ;
- 150 entreprises spécialisées, dont plusieurs à l’oeuvre aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique et en Asie ;
- Plusieurs centres et chaires de recherche de renommée internationale, tel le TechnoCentre éolien à Gaspé.
Par ailleurs, nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur l’hydroélectricité et l’énergie éolienne, deux filières complémentaires que plusieurs pays nous envient. L’énergie éolienne permet en effet d’accumuler l’eau dans les réservoirs des grandes centrales hydroélectriques et de l’exploiter au moment optimal, soit pour répondre à nos propres besoins lors des heures de pointe, soit pour exporter l’énergie chez nos voisins. Qui plus est, certains États du nord-est américain ont même institué des primes pour cette énergie verte. Enfin, le tandem hydro-éolien nous permet de nous mettre à l’abri des effets de périodes comme celles que nous avons connu en 1995 et en 2005, lorsque les pluies trop faibles ont réduit de façon importante le niveau d’eau dans les grands barrages.
L’énergie éolienne peut aussi contribuer à réduire la consommation de pétrole dans les sites d’exploitation minière ainsi que dans la vingtaine de communautés nordiques qui s’alimentent toujours à partir de génératrices au diesel.
sur notre chaine
FAQ Éolien
Quel est le potentiel éolien du Québec ?
Selon une étude réalisée par la maison Hélimax, le potentiel éolien situé à moins de 25 kilomètres des lignes de transport est effectivement de 100,000 MW au Québec. Or, si l’on considère l’ensemble des régions indépendamment de la proximité des lignes, il faut multiplier par quatre ce potentiel.
Toutefois, les réseaux traditionnels ne peuvent absorber toute l’énergie éolienne disponible.
Certains pays comme le Danemark et certaines régions en Allemagne et en Espagne comptent désormais sur l’énergie éolienne pour combler plus de 20 % de leurs besoins.
Au Québec, l’objectif officiel de 4000 MW d’énergie éolienne en 2015 permettrait au Québec de combler plus de 10 % de sa demande grâce à l’énergie éolienne.
Actuellement, la capacité totale du réseau d’Hydro-Québec, avec la centrale de Churchill Falls au Labrador, est d’environ 40,000 MW.
L’énergie éolienne est une énergie complémentaire à celle produite par les centrales hydroélectriques. C’est Hydro-Québec qui déterminera le pourcentage du potentiel éolien qui pourra être exploité.
Où y a-t-il le plus de vent au Québec ?
Les premiers parcs éoliens québécois ont été développés surtout en Gaspésie. Pourtant au Québec, ce n’est pas la Gaspésie qui a le potentiel éolien le plus élevé.
La Côte-Nord et le Bas Saint-Laurent, avec respectivement des potentiels de 35,880 MW et de 19,596 MW, pourraient en théorie accueillir plus de parcs éoliens que la Gaspésie.
En Gaspésie, on estime le potentiel à 14,460 MW. Si le développement éolien a débuté en Gaspésie, c’est que cette région, durement éprouvée par les difficultés économiques au niveau de la pêche, du bois et des mines, a revendiqué pour elle-même, depuis le début des années 2000, le développement éolien.
Tant le gouvernement du Parti Québécois que celui du Parti Libéral du Québec ont accédé aux demandes de la région.
Le coût d’intégration au réseau de transport d’Hydro-Québec de l’énergie éolienne y est plus élevé parce que la société d’État est contrainte d’y construire une ligne de transport de 430 $ millions pour transporter l’énergie de 4 parcs éoliens. Dans d’autres régions du Québec, mieux pourvues en lignes de transport, le coût d’intégration serait plus bas. En Gaspésie le 1,3 cents le kWh s’ajoute au prix de 6,5 cents le kWh des producteurs privés.
L’obligation de respecter un contenu régional « gaspésien » de 60 % augmente encore le prix de l’énergie fournie par les parcs éoliens gaspésiens. Les ententes de gré à gré avec des producteurs privés qui n’avaient pas à respecter une contrainte de 60 % de contenu régional ont été signées à moins de 6 cents le kWh.
C’est donc l’ensemble des consommateurs québécois qui par le biais des appels d’offres d’Hydro-Québec, subventionnent le développement éolien en Gaspésie. Si on avait laissé le marché faire son travail, le coût des projets éoliens au Québec aurait été inférieur à ce qu’il était dans le cadre du premier appel d’offres de 1000 MW.
Qui est le maître d’œuvre du développement éolien au Québec ?
Bien que la production de l’énergie électrique d’origine éolienne a été confiée au secteur privée, Hydro-Québec demeure le maître d'oeuvre du développement éolien sur le territoire québécois. Le Québec n’est pas une exception; c’est la règle générale à travers le monde.
C’est Hydro-Québec qui fixe les conditions d’achat avec les producteurs privés d’électricité. En tant qu’acheteur et distributeur, Hydro-Québec continue d’avoir le monopole sur l’électricité produite au Québec, quelle qu'en soit l’origine (hydraulique, éolienne, thermique, cogénération au biogaz ou nucléaire).
C’est aussi Hydro-Québec qui conçoit et formule les appels d’offres avec un contenu régional. C’est encore Hydro-Québec qui fixe les conditions de livraison et c’est Hydro-Québec qui choisit les soumissionnaires en fonction du prix mais aussi en fonction d’autres critères comme celui de l’expérience du promoteur.
Hydro-Québec est un acheteur « actif » d’énergie éolienne. C’est la société d’État qui décidera si elle peut accepter que plus de 10% d’énergie éolienne soit intégrée à son réseau. C’est pourquoi on peut dire qu’Hydro-Québec est sans contredit le seul maître d’œuvre de l’énergie éolienne au Québec.
Qui sont les grands fabricants d’éoliennes ?
Ce sont les Danois, les Allemands et les Espagnols qui ont permis l’émergence d’une technologie éolienne qui a suscité l’intérêt du monde entier.
Deux éoliennes sur trois dans le monde sont aujourd’hui implantées en Europe.
Les grandes compagnies comme Vestas, Enercon, Siemens, Furlander et Gamesa, sont européennes. Même General Electric, dont les éoliennes tournent en Gaspésie depuis la mise en service des parcs du premier appel d’offres de 1000 MW, a importé sa technlogie qui avait été d'abord développée en bonne partie en Allemagne.
Au cours des vingt dernières années, la progression de la technologie a été spectaculaire.
Il y a 10 ans, le prix de l’énergie éolienne au Canada était de 30 cents le kWh; il varie aujourd’hui entre 6 et 10 cents le kWh.
Est-ce qu'on ne devrait pas nationaliser la production d’énergie éolienne ?
La nationalisation n’apporterait aucun avantage supplémentaire aux consommateurs québécois. Partout à travers le monde, la production d’énergie éolienne a été confiée au secteur privé.
Les arguments sont les mêmes partout; flexibilité et souplesse d’exécution, sans compter que les entreprises prennent à leur compte la plupart des risques associés à la production de cette forme d’énergie. Lors du premier appel d’offres, le prix offert par les producteurs privés de 6,5 cents le kWh a surpris les observateurs.
Pourquoi voudrait-on maintenant transformer un secteur concurrentiel en monopole ?
Même si la production de l’énergie éolienne a été confiée au secteur privé, Hydro-Québec reste le maître d’œuvre du développement de l’énergie éolienne au Québec. C’est toujours la société d’État qui a le monopole du transport, de la distribution et de l’achat d’électricité qui pourrait être produite par les entreprises privées pour être vendue par la suite sur le marché domestique ou sur les marchés d’exportation.
Qui absorbe les risques du développement éolien ?
Les entreprises privées prennent la plupart des risques associés au développement de l’énergie éolienne. Les contrats signés entre Hydro-Québec Distribution et les promoteurs prévoient une forme d’indexation. Cela peut paraître rassurant, mais pour les promoteurs c’est le début d’un long parcours, car une fois le contrat signé il faut implanter le parc éolien.
Comme dans tout projet les entreprises doivent faire face aux risques relatifs aux dépassements des coûts de construction, au vent qui n’est pas toujours au rendez-vous, aux changements climatiques sur une période de 20 ans, au financement du projet, et finalement à son acceptation par la communauté et les autorités réglementaires.
Au Québec, qui bénéficie des retombées de l’énergie éolienne ?
Les premières ententes de gré à gré entre Hydro-Québec Production et les entreprises ont été d’abord limitées à la Gaspésie et le premier appel d’offres de 1000 MW en 2004 prévoyait la construction de huit parcs éoliens dans la péninsule gaspésienne au cours de la période de 2006 à 2012.
Or, les gagnants du 2ième appel d’offres de 2000 MW d’Hydro-Québec Distribution développent des projets dans le Bas St-Laurent, la région de la Capitale Nationale, Chaudières-Appalaches, en Estrie, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en Montérégie et au Saguenay-Lac-St-Jean.
Dans le cadre des ententes de gré à gré, il n’y avait aucune exigence de contenu régional. Avec le premier et deuxième appel d’offres, les exigences de contenu régional peuvent atteindre les 60 %. La Gaspésie profitera encore du 2ième appel d’offres mais à la hauteur de 30 % du contenu des éoliennes au lieu de 60 % comme c’était le cas lors du premier appel d’offres. L’autre 30 % de contenu régional sera réservé aux régions qui accueilleront les éoliennes.
Les retombées sont donc multiples; pour les régions, les municipalités et les agriculteurs qui reçoivent des contributions annuelles des producteurs d’énergie éolienne pendant la durée du contrat de 20 ans.
L'énergie éolienne coûte-t-elle cher aux contribuables du Québec ?
Lors du premier appel d’offres de 1000 MW, les producteurs privés ont déposé des offres de 1,2$ milliard inférieures aux prévisions sur une période de vingt ans.
En 2004, les observateurs tant d’Hydro-Québec que de l’extérieur s’attendaient à un prix moyen de 8, 5 cents, voire de 9,5 cents le kWh la première année.
Le prix moyen a plutôt été de 6,5 cents le kWh.
Cette différence de 2 cents le kWh pour une tranche de 990 MW représente sur 20 ans 1,2$ milliard que n’auront pas à débourser les consommateurs québécois.
À 6,5 cents le kWh, les projets éoliens coûtent moins chers que certains projets hydroélectriques comme Chute/Rapide-des-cœurs à 8 cents le kWh et la rivière Romaine à 9 cents le kWh.
En Europe et en Ontario, on a offert plus de 10 cents le kWh pour produire de l’énergie éolienne. Cela a fait dire à une publicité gouvernementale : « L’énergie éolienne au meilleur coût : c’est propre au Québec ».
Le développement éolien est-il accessible aux communautés ?
Lors du premier appel d’offres de 1000 MW en 2004, aucune Municipalité régionale de comté n’a soumis de proposition. Pourtant rien n’empêchait des groupes de citoyens, d’agriculteurs, de coopératives ou de syndicats de soumettre des propositions.
Un projet éolien sur une période de vingt ans comporte des risques. Les risques relatifs au vent qui n’est pas toujours au rendez-vous, aux changements climatiques, aux autorisations gouvernementales, à la construction et au financement du projet.
Même les grandes sociétés d’État à travers le monde ont trouvé plus sage de confier au secteur privé la production d’énergie éolienne.
En Europe où le prix de vente de l’énergie éolienne est beaucoup plus élevé (13 cent du kWh en France versus 6,5 cents le kWh au Québec), il est plus facile de rentabiliser des projets communautaires.
La nouvelle politique énergétique du gouvernement québécois dévoilée au printemps 2006 prévoit explicitement réserver 250 MW aux MRC et 250 MW aux Nations autochtones. Le prix pourrait être plus élevé que les appels d’offres, et les MRC et les Nations autochtones pourront s’associer aux producteurs privés afin de réduire le risque d’investir dans l’éolien.
Les règlements concernant l’implantation des éoliennes sont-ils différents d’une région à l’autre ?
Oui. Au cours de la dernière année, plusieurs municipalités régionales de comté ont adopté des règlements de contrôle intérimaire (RCI) pour baliser l’implantation des éoliennes sur leurs territoires.
Au Québec, on compte actuellement plus d’une vingtaine de RCI.
Ces règlements sont différents d’une région à l’autre et sont adoptés démocratiquement par les maires qui siègent aux MRC.
Certaines régions comme la MRC de Kamouraska, de Brome-Missisiquoi et de Memphémagog ont adopté des RCI plus contraignants en excluant des zones importantes de leurs territoires aux promoteurs.
Mais toutes les MRC qui ont adopté des RCI prévoient des distances minimales à respecter par rapport aux habitations, aux périmètres urbains et aux zones protégées.
Les municipalités sont obligées de se conformer aux RCI mais peuvent adopter des mesures encore plus contraignantes pour interdire l’implantation des éoliennes sur leur territoire.
Les éoliennes sont-elles bruyantes ?
Les éoliennes d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec celles du début des années 80.
Vous pouvez tenir une conversation tout à fait normale au pied d’une éolienne récente.
À trois cents mètres d’une éolienne, on risque d’entendre davantage le bruit des feuilles que le bruit des éoliennes. Près d’une route fréquentée ou d’une autoroute, le son de l’éolienne sera vite étouffé par les sons ambiants.
Même une brise légère peut facilement noyer le bruit des éoliennes.
Le bruit des éoliennes est si faible qu’il ne serait pas perceptible dans la plupart des zones résidentielles du Québec.
Les éoliennes sont-elles une menace importante pour les oiseaux ?
Les éoliennes peuvent tuer des oiseaux, tout comme les édifices publics, les lignes à haute tension, les automobiles et les chasseurs.
Des études menées tant en Europe qu’aux États-Unis ont démontré qu’il n’y avait aucune comparaison à faire entre les éoliennes et les tours de communications, les lignes à haute tension, les fenêtres des édifices publics et les pesticides qui tuent, toute proportion gardée, beaucoup plus d’oiseaux que les éoliennes.
Aux États-Unis, on estime que chaque éolienne est responsable de la mort d’environ deux oiseaux par année. Les études européennes sont généralement encore plus conservatrices.
Toutefois les promoteurs doivent tenir compte de l'impact des corridors migratoires avant de proposer un parc éolien. Ces corridors migratoires font habituellement l'objet des audiences publiques du Bape.
Les éoliennes sont-elles mauvaises pour l'industrie touristique ?
Tant ici qu’en Europe, les études ont démontré que les touristes évaluent positivement la présence d’éoliennes.
En fait, les éoliennes sont associées à l’énergie verte et renouvelable.
Il y a une condition à ce verdict positif : il ne faut pas que ces dernières soient déployées de manière à altérer les paysages qui constituent l’attrait touristique d’une région.
Dans certains cas, les éoliennes peuvent même constituer un facteur d’attraction pour les touristes. C’est le cas au Danemark, où des éoliennes ont été implantées depuis plus de vingt ans sur la terre ferme et depuis plus de cinq ans dans la mer au large des côtes.
Les promoteurs éoliens se soucient-ils des paysages ?
Tout promoteur responsable doit tenir compte des paysages.
L’intégration visuelle des parcs éoliens avec la nature environnante fait partie de toute planification intelligente d’un projet de ferme éolienne.
La population est sensible aux paysages et un promoteur aura beaucoup de difficulté à réaliser son projet s’il va à l’encontre du sens commun.
Plus d’une vingtaine de municipalités régionales de compté (MRC) ont inscrit dans leurs schémas d’aménagement ou voté des règlements de contrôle intérimaire (RCI) afin de préciser les règles d’implantation des éoliennes. Ces règles ne sont pas universelles et varient de région en région, selon les paysages, les parcs et les milieux naturels à protéger.
L’évaluation de l’impact visuel fait partie intégrante du processus d’audiences publiques du BAPE
Les éoliennes sont-elles mauvaises pour la valeur des propriétés ?
La valeur des propriétés ne semble pas affectée de façon négative par l’implantation d’éoliennes.
Les études sur le sujet restent toutefois limitées.
Des études abondent même dans le sens d’une appréciation de la valeur des propriétés. Il faut donc éviter de conclure à une dépréciation de la valeur des propriétés suite à l’implantation de parcs éoliens.
Combien peut-on obtenir en redevances pour l'implantation d'une éolienne sur sa propriété ?
Au départ, l’agriculteur recevra 1500 $ par année par éolienne pour la durée du contrat de 20 ans. C’est l’exemple d’un agriculteur ayant signé un contrat avec le promoteur du premier parc éolien issu du premier appel d’offres de 1000 MW (mégawatts).
De plus, il recevra 35 $ dollars par hectare. Si la superficie totale de sa propriété représente 35 hectares il recevra donc 1470 $, soit au total près de 3000 $ par année.
Pour toucher ces redevances, le propriétaire signe un acte superficiaire d’une durée de 20 ans qui donne au promoteur une servitude afin d’y installer une éolienne.
Les retombées économiques du développement éolien au Québec
Les attributs environnementaux sur le marché américain
Lorsqu'elle est exportée aux États de la Nouvelle-Angleterre, l'électricité produite par la filière éolienne québécoise génère des attributs environnementaux (RECs) qui lui confèrent une prime pouvant se chiffrer jusqu'à 6,4 cents du kilowattheure. Vous trouverez ici le rapport rédigé par La Capra Associates sur la valorisation des attributs environnementaux. (Disponible en anglais seulement.)
Investissements réalisés et à venir
En date de mars 2013:
- 5,8 milliards $ ont été investis dans des projets réalisés ou en cours, dont
- 3,5 milliards $ déployés au Québec
D'ici 2015:
- 8,0 milliards $ auront été investis, dont
- 5,0 milliards $ déployés au Québec (61 %)
Des dépenses d'opération importantes
- 3 millards $ sur 20 ans en dépenses d'opération
- Plus de 25 millions $ par année versés aux municipalités et aux propriétaires terriens accueillant des parcs éoliens (n'incluant pas les retours sur investissement des municipalités qui prendront des participations dans les projets.)
Sous-catégories
Énergie éolienne - technologie
Les éoliennes captent le vent par leurs pales et acheminent sa puissance vers une génératrice. Cette dernière transforme l’énergie cinétique en énergie électrique. Afin d’optimiser leur rendement, la position des pales peut être ajustée en fonction de la direction du vent.
Énergie éolienne - environnement
IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
- Réduit les gaz à effet de serre en remplaçant les énergies fossiles;
- Ne génère ni déchets, ni pollution de l’air;
- À ce jour, aucune autre forme de production d’énergie n’a un bilan plus favorable !
FAQ
Vos questions n'apparaissent pas ici ? Transmettez-les à info@aqper.com et nous tenterons d'y trouver réponse.